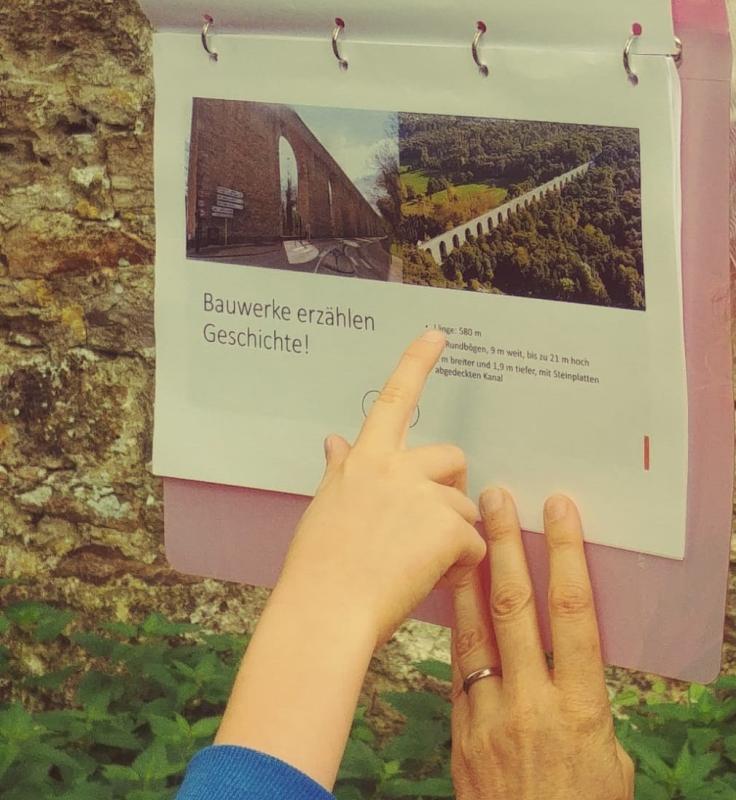Les étincelles du palais de la découverte : sortie du 29 mars
 Les classes de 3A et 4B devant les étincelles du palais
Les classes de 3A et 4B devant les étincelles du palais
Le 29 mars, notre classe de 4ème B et la classe de 3ème A avons fait une sortie aux étincelles du palais de la découverte, annexe du vrai palais de la découverte momentanément en travaux, située dans le 15ème arrondissement de Paris. Après environ 40 minutes de car, nous sommes arrivés devant le bâtiment d’une forme assez atypique car il est composé de pyramides colorées. Nous avons pu assister à 2 exposés :
Le premier concernait les poisons. Là, nous avons parlé de nombreuses espèces vénéneuses, tel le dendrobate bleu, une espèce de crapaud reconnaissable à sa couleur bleu électrique, dont la peau est composée de glandes à venins divers, et dont la couleur très vive sert d’avertissement aux prédateurs pour qu’ils ne l’approchent pas. D’autres espèces comme le serpent corail par exemple utilisent aussi cette technique de prévention. Nous avons aussi discuté autour de la célèbre citation de Paracelse : Toutes les choses sont poison, et rien n’est sans poison ; seule la dose fait qu’une chose n’est pas poison. En effet, à chaque substance existe une posologie plus ou moins élevée. Par exemple, pour le chlorure mercurique, substance très toxique, 1 g, soit une demi-cuiller à café suffit à être mortelle. Cependant, pour tuer avec de l’eau, il faut ingérer 8,3 L soit l’équivalent de 5,5 bouteilles de 1,5L. Des morts par hyperhydratation sont ponctuellement signalées surtout après des concours d’ingestion d’eau.
Le 2ème exposé parlait de l’électrostatique. C’était très intéressant car beaucoup de matériel a été manipulé : la présentatrice a fait apparaitre des éclairs et des bruits. On a aussi réalisé plusieurs expériences, par exemple une élève de notre classe est venue devant et ses cheveux se sont dressés sur sa tête. Nous avons aussi observé que si l’on frottait un bâton en plastique contre une peau de chat (comme ici) ou contre de la laine, cela fait se dresser les cheveux sur la tête. Enfin nous avons fait une expérience où toute la classe a pu participer : nous nous sommes tenu les mains pendant que la scientifique allumait le générateur avec lequel la première personne de la chaine était en contact. On a ressenti une petite décharge quand le courant traversait les mains jointes c’était vraiment très intéressant et ludique.
Elsa de Cara , élève de 4B
 Exposé d’électrostatique, à en dresser les cheveux sur la tête !
Exposé d’électrostatique, à en dresser les cheveux sur la tête !